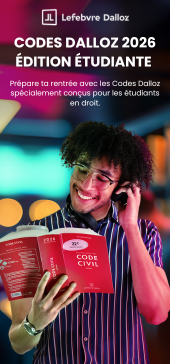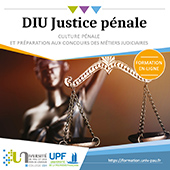Actualité > À vos copies !
À vos copies !

Droit de la famille
Modalités d’exercice de l’autorité parentale et information du mineur
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-11.604.
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation/CEDH a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
■ Sélection des faits : En 2022, le père de deux enfants nés en 2012 et en 2014 saisit un juge, en suite de sa séparation avec leur mère, pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
■ Qualification des faits : Un père saisit un juge aux affaires familiales pour voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale de ses deux enfants mineurs, âgés de huit et dix ans.
■ Procédure : La cour d'appel fixe les modalités relatives aux droits de visite et d'hébergement ainsi que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
■ Moyens du pourvoi : La mère reproche aux juges du fond de s'être prononcés sans vérifier que ses enfants mineurs ont eu la possibilité d’exprimer leur opinion sur les modalités retenues de l’exercice de l’autorité parentale, alors que le juge a en principe l’obligation de s’assurer que les parents se sont effectivement acquittés de leur obligation d'information à l’égard de leurs enfants, concernant le droit de ces derniers d'être entendus et d’être assistés d'un avocat lors d’une procédure qui les concerne.
Le père conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que dans ses conclusions, la mère, en dépit de l'avis qui lui avait été délivré, n'a pas justifié du respect de l'obligation faite aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus, ni fait référence à la nécessité d'une audition, de même qu’elle ne s’est pas prévalue de ce que l'information des enfants, dont elle avait la charge, n'aurait pas été assurée.
■ Problème de droit : Sur qui repose la charge de prouver l’effectivité de l’information à délivrer aux enfants concernant leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale ?
■ Solution : Selon l'article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.
Selon l'article 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'en dépit de l'avis qui lui a été délivré le 18 août 2023 enjoignant aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, la mère des enfants n'a pas déféré à la demande qui lui était faite d'en justifier.
En conséquence, celle-ci n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient.
I. Les personnes chargées de l’information du mineur de son droit d’audition et d’assistance
A. L’obligation des parents
-Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant a le droit d’être entendu par un juge et assisté d’un avocat dans toute procédure le concernant, telle que celle organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale (C.civ. art. 388-1), et ce même lorsqu’il n’en fait pas directement la demande, celle-ci pouvant être également sollicitée par ses parents ou par l’un d’entre eux, ainsi que par le juge, lorsqu’il estime nécessaire d’associer l’enfant à la procédure ; en outre, l’audition de l’enfant discernant est de droit dès lors que ce dernier en fait lui-même la demande et ce, à tous les stades de la procédure (C.civ., art. 388-1, al.2 ; C. Pr. Civ., art. 338-4) ;
-Dans ce cadre procédural, les parents ont l’obligation d’informer leur enfant de son droit d'être entendu par le juge et assisté par un avocat ; cette obligation d’information incombe aux parents de l’enfant, en qualité de titulaires de l’autorité parentale, et non au juge : « le mineur capable de discernement est informé par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant" (C. Pr. Civ., art. 338-1); en ce sens, le décret du 20 mai 2009, relatif à l'audition de l'enfant en justice, est venu préciser que l'acte introductif d'instance, la requête ou l'assignation, doit être accompagné d'un avis rappelant aux parents, par la double reproduction des dispositions de l'article 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile, leur obligation d'informer leurs enfants de leurs droits procéduraux ; en l’espèce, alors que les deux enfants du couple concernés par la procédure engagée ont l’âge de discernement, la mère du mineur est passée outre l’avis qui lui avait été adressée pour lui rappeler son obligation légale d’information et n’a pas accédé à la demande du juge de justifier de sa bonne exécution ;
-Débiteurs de cette obligation d’information, les parents ont également la charge de la preuve de son effectivité ; c’est donc à celui qui en conteste l’exécution de le prouver, soit en l’espèce à la mère de l’enfant : « la charge d'une telle information et la justification de son exécution incombaient (à la mère) ».
B. Le contrôle du juge
- C.civ., art.388-1 in fine du Code civil : le juge doit s'assurer que le mineur a été effectivement informé de ses droits d’être entendu et assisté. Garant de l’effectivité de son information, le juge doit vérifier que ses parents s’en sont valablement acquittés (attestation sur l'honneur du ou des parents) ; il doit en principe faire mention de l’exécution de cette obligation d’information dans la procédure ;
- Bien que le pouvoir de contrôle du juge soit indispensable à la garantie des droits procéduraux du mineur, la délivrance de l’information relative à l’existence de ses droits et la justification de son exécution incombent à ses seuls parents ; le juge n’est pas tenu d’accomplir ce devoir informatif, qui constitue un devoir parental, ni même de le parfaire s’il se révèle déficitaire ou défaillant; son rôle se limite à contrôler l’effectivité de l’information délivrée au mineur par ses parents et à en faire mention dans sa décision, en s'assurant que ce dernier a bien été informé par ses parents de ses droits dans la procédure en cause, mais il est lui-même dispensé d’exécuter tout ou partie de cette obligation d’informer, même lorsque les parents ont manqué de s’en acquitter ;
-Obligations du juge restreintes à un rôle de supervision (vérifier que l’obligation a été effectivement délivrée) : les parents sont placés au cœur du dispositif informatif du mineur prévu aux fins de garantir l’effectivité de ses droits procéduraux à être entendu par un juge et assisté d’un avocat.
II. L’impossibilité de contester l’effectivité de l’information du mineur
A. Absence de recours des parents
- Le parent ayant sollicité l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale n’est pas recevable à reprocher au juge d’avoir omis de rechercher si le mineur avait été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat, ni de l’avoir mentionné dans l’arrêt, dès lors que la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient : la Cour de cassation déduit ainsi de l'obligation pour les parents d'informer leur enfant de ses droits dans la procédure, et de leur charge d’en rapporter la preuve, l'impossibilité pour eux de contester la décision du juge ayant omis de rechercher si le mineur a été valablement informé de ses droits et de les mentionner dans l’arrêt ;
- Cette impossibilité de contestation traduit l’ampleur de l’obligation parentale d’information : dans la mesure où ils sont eux-mêmes et seuls chargés d’accomplir cette obligation d’information, ils sont les mieux placés pour savoir si l'enfant a été effectivement informé de ses droits d’audition et d’assistance et ne peuvent donc reprocher au juge de ne pas avoir, le cas échéant, pallier leurs lacunes ; l’attribution aux parents de la charge de prouver l’effectivité de cette obligation leur interdit de contester pour ce motif la décision du JAF sans inverser la charge de la preuve ; enfin, le formalisme normalement applicable est dans ce cas atténué pour empêcher que les parents prennent prétexte d’une prétendue méconnaissance des droits de l'enfant dans une procédure pour remettre en cause une décision qui leur est défavorable : comme le rappelle la Cour, le défaut de mention dans la décision du juge de l'information effective du mineur n'est pas contestable dès lors que cette charge informative et la preuve de son exécution incombent au parent (v. déjà, Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-23.502 ; Civ. 1re, 17 oct. 2007, n° 07-11.449).
- Cette solution amoindrit le rôle du juge mais ne conduit pas à remettre en cause son obligation de vérifier que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat, qui demeure inchangée ; il n’est certainement pas dispensé de son devoir de contrôler l'effectivité de l'information de l'enfant sur ces droits procéduraux, mais l’exécution de cette obligation ne saurait faire l'objet d'un recours de la part d'un des parents qui doivent eux-mêmes fournir à l'enfant l'information en cause.
- Par cette décision, la Cour de cassation confirme l’impossibilité pour l’un des parents d'utiliser l’argument dilatoire de l'absence d’information de l'enfant pour faire annuler l'audition et la décision rendue à la suite de celle-ci, sauf, peut-être, à démontrer que le juge n'a pas fait part aux parents de l'obligation d'information de l'enfant qui pèse sur eux, hypothèse exclue en l’espèce.
B. Absence de recours de l’enfant
- En raison de son défaut de qualité et de capacité pour agir dans la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale ;
- En outre, l'article 338-5 du Code de procédure civile prévoit que la décision du juge d'entendre le mineur à la demande de ce dernier ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
- Il apparaît que le droit de l'enfant d'être informé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat lors de son audition est laissé à la discrétion du juge. Si les parents de l'enfant ne l'ont pas informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de son audition et que le juge ne vérifie pas au moment d'entendre l'enfant que celui-ci a été avisé de son droit, aucun recours ne paraît envisageable…
Autres À vos copies!
-
Droit des obligations
[ 2 décembre 2025 ]
Incidence de la conclusion d’un contrat à distance sur l’exercice du droit de rétractation
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 21 octobre 2025 ]
Droit à la vie privée versus Liberté d’expression
-
Droit de la responsabilité civile
[ 16 septembre 2025 ]
Limite au refus d’obliger la victime à minimiser son dommage
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 1 juillet 2025 ]
Protection des victimes mineures de violences sexuelles : condamnation de la France
-
Droit des obligations
[ 27 mai 2025 ]
Durée de l’obligation d’information annuelle due à la caution personne physique
- >> Tous les "A vos copies !"