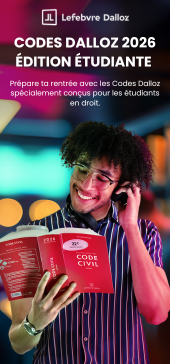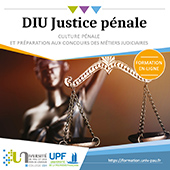Actualité > Le cas du mois
Le cas du mois

Droit des obligations
Sous-location illicite
Alors même que Lucienne Quiloutou, la petite cousine germaine de Désiré et d’Adhémar, a toujours eu un comportement exemplaire qui la rendait appréciée de tous, elle vient de se mettre à dos une bonne partie de sa famille, à l’exception de ses deux cousins favoris.
Les garçons viennent d’apprendre que depuis trois ans, Lucienne sous-loue l’appartement que les parents de Désiré, qui en sont les propriétaires, ont eu la gentillesse de mettre à sa disposition dès son arrivée à Paris, en 2022, lorsqu’elle débuta des études de mode dans une école réputée de la capitale. Or, au lieu de profiter de cet appartement, idéalement situé près de la Tour Eiffel, leur cousine a préféré recourir à la fameuse plateforme Airbnb pour en tirer finance, sans l’accord de ses oncle et tante, qui n’ont jamais rien su de ces sous-locations, auxquelles ils se seraient naturellement opposés, d’autant plus qu’elles sont, aux dires de leurs voisins, aussi régulières que nuisibles. En effet, un copropriétaire a contacté les parents de Désiré pour leur faire part de la présence fréquente de résidents de passage et de nombreux déménagements, à l’intérieur de leur appartement, occasionnant d’importants troubles de voisinage à la copropriété. Prenant enfin conscience du problème, les parents de Désiré ont alors immédiatement appelé Lucienne pour lui demander de cesser au plus vite ces agissements, sous peine de devoir quitter l’appartement. Malgré l’affection qu’ils portent à leur nièce, ils n’ont aucune envie de se fâcher avec leurs voisins ni de voir détériorer leur bien puisque d’après le syndic, les sous-locataires de Lucienne ont pour point commun une indifférence manifeste au respect des biens d’autrui. Ils ont en effet dégradé plusieurs parties communes et gardé, malgré les avertissements répétés de la copropriété, la fâcheuse habitude de jeter leurs mégots de cigarettes dans le jardin de l’immeuble. Pourtant, Lucienne affirme et confirme à ses oncle et tante qu’elle ne fait résider personne d’autre qu’elle-même dans l’appartement. Cette contradiction entre les assertions de leur nièce et les faits constatés par l’ensemble des résidents de l’immeuble depuis bientôt trois ans a fini d’insupporter les parents de Désiré. Après une première mise en demeure, restée infructueuse, ils envisagent d’assigner Lucienne en justice. Venant au secours de leur petite cousine, les garçons s’opposent fermement à leur dessein contentieux. « On lave son linge sale en famille, pas devant la justice ! », s’insurgent-ils après leur avoir rappelé, à la décharge de Lucienne, qu’à l’instar de nombreux étudiants, leur nièce rencontre des problèmes d’argent aussi récurrents que les sous-locations auxquelles elle recourt pour y faire face. « Alors, quoi ? Il faudrait qu’on se laisse faire pour protéger Mademoiselle Quiloutou et lui assurer l’impunité alors qu’elle se fait de l’argent sur notre dos ? », rétorquent les parents de Désiré avec un agacement légitime. « Vous n’avez qu’à attaquer directement la société Airbnb », leur oppose leur fils. « Quand on y réfléchit bien, c’est finalement elle, la véritable responsable. Elle profite de la détresse financière de nombreux locataires pour transformer en business juteux un commerce qu’elle sait illicite ! », poursuit-il. L’alternative proposée par Désiré semble aux yeux de sa famille un défi difficile, voire impossible, à relever. « Sur le fond, tu n’as pas tort, mais ta démarche n’est pas du tout réaliste. Airbnb n’est pas une société comme une autre. Comme toute société gérant une grosse plateforme numérique, son statut d’hébergeur la protège », soutient Adhémar. « C’est quoi, un hébergeur ? » demande la mère de Désiré. « En gros, c’est une entreprise qui fournit aux internautes un espace numérique pour stocker et gérer des données, mais elle offre seulement l’infrastructure, sans contrôle des données, ce qui la rend en principe irresponsable. C’est cette immunité à laquelle Adhémar faisait référence », lui répond son fils d’un ton exaspéré, comme à chaque fois qu’il essaie de combler l’inculture numérique de sa mère. « Cela étant, ce statut d’hébergeur est assez complexe, et je ne suis pas sûr qu’Airbnb puisse en bénéficier, d’autant moins que la législation évolue beaucoup sur la question du statut des grandes plateformes. Il faudrait se renseigner. », lance Désiré à son cousin, qu’il trouve un peu trop sûr de lui.
Pour clore ce débat familial et tenter d’y voir plus clair, Désiré et Adhémar font encore une fois appel à vous. Votre éclairage compte d’autant plus pour eux qu’au fond, ils souhaitent moins s’attaquer à cette grande société que protéger leur petite cousine, qu’ils ont toujours adorée.
Réponses d’ici une quinzaine de jours.
Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz
Autres Cas du mois
-
Droit de la responsabilité civile
[ 6 janvier 2026 ]
Gare à la balle
-
Droit des obligations
[ 11 novembre 2025 ]
Campement d’infortune
-
Droit de la responsabilité civile
[ 30 septembre 2025 ]
Il n’y a pas que le résultat qui compte
-
Droit de la responsabilité civile
[ 3 juin 2025 ]
Tout feu, tout flamme
-
Droit des obligations
[ 25 mars 2025 ]
Le compte n’est pas bon
- >> Tous les Cas du mois