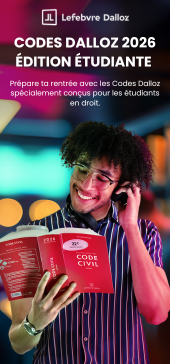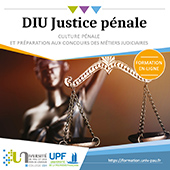Actualité > Focus sur...
Focus sur...

10 ans depuis l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats
Impulsée par la doctrine (Avant-projet Catala-Viney ; Avant-projet Terré, v. l’interview de François Terré pour DAE en 2011), la réforme du droit des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, pour les contrats conclus à partir de cette date. Modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette réforme a aujourd’hui 10 ans. Mathias Latina, professeur à l'Université de Côte d’Azur, nous fait le grand plaisir de répondre à nos questions sur cet anniversaire.
Quels sont les principaux changements apportés par la réforme ?
Lors de la publication de l’ordonnance du 10 février 2016, un certain nombre de dispositions ont attiré l’attention de la doctrine, en ce qu’elles étaient porteuses d’un changement radical. Elles dénotaient ainsi au sein d’une réforme dans laquelle beaucoup ne voyaient qu’une codification « à jurisprudence constante ». La consécration de la révision judiciaire pour imprévision (C. civ., art. 1195), qui sonnait le glas du vénérable arrêt du Canal de Craponne (Civ., 6 mars 1876) ou la reconnaissance de l’inefficacité de la rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de contrat (C. civ., art. 1124), qui brisait l’arrêt Cruz (Civ. 1re, 15 déc. 1993), ont donc suscité l’intérêt puisqu’elles constituaient des ruptures dans une matière qui avait connu, jusque-là, une stabilité relative. La création d’un vice d’abus de dépendance, rattachée à la violence (C. civ., art. 1143), a également fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle élargissait considérablement le champ de la violence économique que la Cour de cassation avait timidement consacrée dans la jurisprudence Bordas (Civ. 1re, 3 avr. 2002). Mais c’est sans doute la figure du contrat d’adhésion, dont la définition a été modifiée en 2018, qui constitue une innovation majeure. Cette reconnaissance implique un changement de paradigme : le Code civil admet qu’il existe des rapports de force que le droit commun doit prendre en compte. Plus généralement, la situation dans laquelle les contractants se trouvent n’est plus considérée comme indifférente vis-à-vis du droit commun des contrats, les relations contractuelles n’étant plus, en ce domaine, désincarnées.
Les nouvelles dispositions de 2016 ont-elles été facilement intégrées par les professeurs, les magistrats, les avocats et les juristes d’entreprises ?
En doctrine, une opposition est apparue entre les auteurs qui, mettant à jour leur manuel, ne virent, dans l’ordonnance de 2016, qu’une codification à jurisprudence constante et ceux qui, focalisés sur les nouveaux textes, tentèrent d’y trouver des lignes de fracture susceptibles, sinon de bouleverser la philosophie traditionnelle du droit contractuel français, au moins de l’infléchir significativement. La vérité se trouve sans doute à mi-chemin. La Cour de cassation a rapidement intégré les nouveaux textes puisqu’elle a même, le plus souvent, anticipé l’application des dispositions de rupture en effectuant des revirements de jurisprudence, sous l’empire du droit ancien, afin de mettre en concordance le droit jurisprudentiel ancien et le nouveau droit textuel. Elle l’a fait à propos de la promesse unilatérale de contrat, mais également de l’exception de disproportion manifeste en matière d’exécution forcée. Cependant, elle a, parfois, comme en matière d’interdépendance contractuelle (C. civ., art. 1186), négligé la lettre des nouveaux textes afin de faire perdurer une jurisprudence dont on pouvait penser qu’elle ne pourrait pas se maintenir sous l’empire de la réforme. Quant aux praticiens, ils ont un peu trop fait usage du caractère supplétif des dispositions du droit commun, ce qui a amené à une éviction, sinon généralisée, au moins fréquente des nouveaux dispositifs que sont, par exemple, la réduction du prix (C. civ., art. 1223) ou l’imprévision (C. civ., art. 1195).
Que révèlent les dix premières années de mise en œuvre de la réforme ?
Le bilan de dix ans de la réforme est contrasté, car, en vérité, l’application des nouveaux textes aux seuls contrats conclus après le 1er octobre 2016 a décalé le contentieux qui permet aux juges de connaître de la réforme et d’en éclairer, si besoin, le sens. Par exemple, le périmètre concret de l’abus de dépendance n’est toujours pas connu. La question se pose toujours de savoir si l’abus est une condition autonome de la mise en application de l’article 1143 du Code civil ou s’il découle nécessairement de la démonstration de l’existence d’un avantage manifestement excessif. Des enseignements jurisprudentiels significatifs ont toutefois été apportés par la Cour de cassation, en particulier, s’agissant des sanctions de l’inexécution. L’on sait, par exemple, qu’en dépit d’une maladresse de rédaction, l’article 1223, alinéa 1er met en place une réduction unilatérale du prix, que le créancier n’a pas à mettre en demeure le débiteur d’exécuter si cette mise en demeure apparaît vaine ou encore que si la réparation en nature a droit de cité en matière de responsabilité contractuelle, elle doit être distinguée de l’exécution forcée en nature, la seconde ne pouvant être ordonnée que pour obtenir l’exécution de l’obligation exactement souscrite par le débiteur. Le cycle infini de la fabrique du droit a ainsi repris son cours, la jurisprudence effectuant son travail d’interprétation et de création, jusqu’au jour, sans doute lointain, où il faudra remettre l’ouvrage du droit commun des contrats sur le métier législatif afin de faire coïncider, à nouveau, le droit textuel avec le droit positif.
Est-elle déjà périmée par les progrès techniques ?
Non, c’est la force de la théorie que de pouvoir embrasser les évolutions technologiques. Certes, ces dernières, et notamment la dématérialisation de la conclusion du contrat et de son support, ne sont pas neutres et l’on peut regretter qu’en 2016, le législateur n’ait pas saisi l’occasion qui lui était donnée pour parfaire et compléter les textes du droit commun relatif aux « contrats électroniques ». Toutefois, il n’y a pas, à proprement parler, de dispositions qui soient périmées du fait du progrès technique. On peut d’ailleurs compter sur les juges pour exploiter la théorie afin de trouver les réponses aux difficultés pratiques que ce dernier suscitera. Au passage, opposer la théorie à la pratique est un non-sens, puisque toute pratique puise à la théorie.
Faut-il s’attendre à des nouvelles règles dans cette matière ?
En droit commun des contrats, il est très improbable que de nouvelles règles législatives voient le jour, ce qui n’est pas nécessairement un mal. La jurisprudence doit pouvoir interpréter un texte ou l’adapter à un contexte nouveau. Il est regrettable, toutefois, que la Chancellerie ait renoncé à introduire, dans la réforme en cours du droit des contrats spéciaux, des dispositions générales relatives aux avant-contrats. Certes, l’ordonnance de 2016, par ses articles 1123 et 1124, a réglé un certain nombre de questions relatives au pacte de préférence et à la promesse unilatérale de contrat. Toutefois, ces deux textes sont loin d’être suffisants. Ils étaient destinés à régler, dans l’urgence, des difficultés pratiques importantes, à une époque où la réforme du droit des contrats spéciaux n’était qu’une chimère. Pourtant, la place de ces textes est indubitablement au sein de cette dernière réforme, dont on dit qu’elle devrait être rendue publique en 2026. C’est là le prochain chantier majeur du droit des contrats.
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
J’ai eu la chance d’avoir des enseignants passionnants, aussi bien à l’Université de Nice, qu’à l’Université Paris 2. Mais c’est le séminaire de DEA de Denis Mazeaud sur le « nouvel ordre contractuel » qui me vient immédiatement à l’esprit au titre de mon meilleur souvenir. J’ai été frappé par le talent oratoire, la qualité de l’analyse et l’honnêteté intellectuelle de Denis Mazeaud et j’ai eu la chance qu’il soit mon directeur de thèse ensuite.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Mes héros sont des héros de Science-fiction, ancrés dans la « pop culture ». Mon héros préféré est donc Albator, corsaire de l’espace créé par Leiji Matsumoto. Quant à mon héroïne préférée, il s’agit de Dana Scully, jouée par Gillian Anderson, dans X-Files, série qui a marqué mon adolescence.
Quel est votre droit de l’homme préféré ?
La liberté de pensée, seule liberté absolue. Ce qui se passe dans le for intérieur ne concerne personne et il faut espérer que l’on ne pourra jamais sonder les reins et les cœurs, comme la science-fiction le prédit…
Autres Focus sur...
-
[ 5 février 2026 ]
Les règles de financement de la vie politique : où en sommes-nous ? Où allons-nous ?
-
[ 29 janvier 2026 ]
Affaire Bonfanti : l’acquisition de la prescription de l’action publique d’un meurtre
-
[ 15 janvier 2026 ]
La France est une République indivisible
-
[ 8 janvier 2026 ]
Sur l’exécution provisoire d’une décision de justice
-
[ 18 décembre 2025 ]
Un beau livre sur l’histoire des avocats !
- >> Tous les Focus sur ...